Le Paris lugubre
La cité Jeanne d’Arc — La cité Dorée (sic)
Gil Blas — 26 novembre 1879
Cet immense Paris, malgré les nombreux travaux qui l'ont purifié, renferme encore dans certains quartiers éloignés du centre des recoins hideux qui semblent appartenir à une autre ville et à une autre civilisation.
On appelle cela le Paris pittoresque. C'est le Paris misérable qu'on devrait dire, car il n'y a là que des malheureux,' des affamés, des pauvres diables enfin qui, serrés les uns contre les autres dans leurs sales taudis, déguenillés, amaigris, vivent Dieu sait comme !
Il faut bien pourtant que ces damnés de la société couchent quelque part. Ils s'entassent pêle-mêle dans les vieilles et puantes cités de la Villette, de Grenelle, de Montrouge et du quartier de la Salpêtrière. Cela vaut mieux encore que de coucher à la corde. D'ailleurs, les hôtels à la corde s'en vont peu à peu. Un des derniers, situé rue des Anglais, près de la place Maubert, a été transformé récemment, et, à l'heure actuelle, on n'y loge plus qu'en garni, à raison de quatre ou dix sous par nuit, selon qu'on veut des draps propres ou qu'on se contente de ceux qui font le mois.
C'est bon pour les aristocrates.
Toutes les cités du pauvre se ressemblent, : en ce sens que dans toutes on rencontre les mêmes dénuements horribles ; les mêmes tristesses d'une existence maudite, et les mêmes souffrances se renouvèlent sans trêve ni merci. Toutes aussi ne sont qu'un amoncèlement de baraques tremblantes et vermoulues, sans air ni lumière, où serpentent quelques obscurs passages que de rares et antiques réverbères à huile font semblant d'éclairer.
Une cependant a une apparence moins délabrée : c'est la cité Jeanne-d'Arc, dans la rue de ce nom, à cinquante mètres environ du boulevard de la Gare, entre la Seine et l'ancienne barrière Fontainebleau. Oui ; vu à distance, cet énorme bâtiment à six étages, avec ses trois portiques de forme ogivale et sa façade de nuance grisâtre percée de baies uniforme, ressemble à une caserne hors de service. Mais l'illusion ne tarde pas à disparaître, et l'on s'aperçoit en approchant que tout cela n'est qu'un trompe-l'œil. Ce que l'on avait pris pour une construction en pierre n'est qu'une immense bicoque en plâtras. Elle a été bâtie en 1871 pour être une ruche industrielle et ouvrière. Elle est devenue une espèce de Cour de Miracles.
Cette cité moderne, en bordure de la rue Jeanne-d'Arc, occupe les numéros 73, 75, 77, 79 et 81. Il n'y a qu'un corps de bâtiment, mais il est coupé dans toute sa profondeur par trois passages qui ouvrent sur la rue. Ce sont les entrées.
Sur ces passages aboutissent les quatorze escaliers de l'endroit. Il y a quatre concierges qui ont 400 fr. par an chacun, sans la perspective de la moindre petite étrenne, cela va sans dire.
La cité Jeanne-d'Arc pourrait abriter huit cents personnes. C'est à peine s'il y en a la moitié. On y loge cependant au jour et à la nuit, à la semaine et au mois. Mais les boutiques des passages sont toutes fermées, et plusieurs chambres ne peuvent être louées parce qu'elles n'ont plus de portes. Et pourquoi, s'il vous plaît, ces chambres sont-elles dépourvues de portes ? Tout simplement parce que des locataires peu délicats s'en sont servis pour faire du feu. On ne les remplace pas, car ce serait peine inutile. Celles que l'on y mettrait auraient bientôt un sort analogue. Règle générale : aussitôt qu'une chambre est vide, les locataires voisins se chauffent avec la porte.
C'est une habitude admise. Les concierges ne peuvent rien à cela. Si les choses continuent de ce train, le jour viendra où les chambres n'auront plus ni portes ni locataires.
Elles ne sont cependant pas inutiles, ces chambres abandonnées. Elles servent de refuge aux mendiants et aux vagabonds du quartier qui vont tranquillement y passer la nuit.
Mais les concierges ? direz-vous. Les concierges sont des concierges sans cordon. Ils n'ont pas à s'occuper des personnes qui entrent ou qui sortent. Cela ne les regarde en aucune façon.
Ajoutez que les portes de la cité ne ferment qu'au loquet et que l'accès des escaliers est absolument libre, le jour comme la nuit; ajoutez encore qu'il n'y a aucune espèce d'éclairage, et vous comprendrez que les noctambules sans asile, au courant de ces diverses circonstances, ne sont pas embarrassés pour trouver là un logis d'occasion. Aussi, en hiver, y a-t-il encombrement de locataires de ce genre. Parfois, les premiers occupants sont troublés dans leur sommeil par de nouveaux arrivants, et alors ce sont des querelles, des disputes qui souvent se terminent par des coups de poings. Le concierge, barricadé dans sa loge, entend tout cela, mais se garde bien de bouger.
L'intérieur de cette cité fait mal à voir. Des logements noirs, mal aérés, aux murs humides, servant à la fois d'atelier, de cuisine et de chambre à coucher ; de sombres couloirs où l'on ne peut marcher qu'avec précaution; des escaliers sans rampes remplis d'immondices ; des fenêtres sans fermetures où sèchent des loques, et partout des exhalaisons fétides: la puanteur de la misère.
Particularité caractéristique ! aucune chambre n'a de cheminée ; aucun ménage n'a de chien ; aucune famille n'est égayée par le chant d'un oiseau ou par la vue d'une fleur.
Ce sont là des accessoires de luxe au-dessus des moyens de ces pauvres gens.
Ceux qui vivent dans de si douloureuses conditions sont des manœuvres, des terrassiers, des hommes de peines, des cordonniers en vieux, des raccommodeurs de faïence, des balayeurs de la voie publique, des marchands de papier à lettre à un sou le cahier et des aveugles authentiques, des estropiés que l'on autorise à stationner sur les ponts.
Les femmes restent au logis, où elles s'occupent de quelques travaux de couture lamentablement rétribués. Maigres, rachitiques, couverts de haillons, les enfants, toujours fort nombreux, baguenaudent dans les rues, cherchant à grapiller n'importe quoi. Quelques-uns vont à l'école. D'autres s'en vont quêter des petits sous aux abords de la gare d'Orléans ou aux Jardin des Plantes.
Toutes ces familles, ou presque toutes, reçoivent les secours ordinaires de l'Assistance publique, c'est-à-dire un sou par jour.
Faut-il ajouter que les loyers sont dans les prix doux ? Une chambre coûte de quatre à six francs par mois, selon l'étage. Pour soixante-dix francs par an, on a un logement au quatrième. Ce sont les mêmes prix, à peu de chose près, qu'à l’ile des singes, de Grenelle, ou au passage Papin, de Charonne.
*
* *
À deux cents pas de la cité Jeanne-d'Arc se trouve une autre cité que l'on appelle, par ironie sans doute, la cité Dorée. Celle-là est aussi vieille que Paris. C'est un long pâté de sordides habitations parallèles au boulevard de la Gare, et s'étendant depuis la rue Jenner jusqu'à la place Pinel : une longueur d'environ cent mètres.
Il n'y a là que de pitoyables masures en terre n'ayant généralement qu'un étage, quelquefois rien que le rez-de-chaussée. Aux étroites et irrégulières croisées, garnies de carreaux de papier, se balancent, accrochées à des ficelles, des loques de toute sorte et de toute couleur. Sur le seuil des portes entr'ouvertes, des tas de chiffons ramassés pendant la nuit, car c'est ici que réside la colonie toute entière des chiffonniers du quartier. De çà et de là, quelques boutiques aux portes basses et étranglées, où l'on vend de la ferraille, des souliers d'occasion, des nippes Invraisemblables et des comestibles de rebut venant on ne sait d'où.
Pour quatre sous on a ce qu'on appelle un assortiment composé de petits morceaux de différents fromages, de fragments de saucissons et des débris d'oignons cuits ayant fait partie d'un ragoût quelconque. Le reste, à l'avenant, il va sans dire qu'il y a aussi deux ou trois mastroquets, chez lesquels on peut boire le véritable élixir de biffin à cinq centimes le verre.
C'est sans doute comme dédommagement à tant de laideurs et à tant de pauvretés que l'on a donné aux deux rues de ce cloaque les noms pompeux de passage Doré et d'Avenue Constance-Philippe. Il faut aller au Champ-aux-Loups de Clignancourt ou aux ruelles avoisinant la Butte-Verte de la Villette pour trouver quelque chose de semblable. Quelles voies de circulation, bon Dieu ! Elles n'ont ni trottoir ni pavé, et elles sont si étroites que l'on a dû renoncer à y placer le moindre appareil d'éclairage.
Pourtant — il faut être juste — elles possèdent deux réverbères chacune ; mais ils sont incrustés dans les murs, comme des saints dans leurs niches. Un débitant de boissons, relativement très éloigné de ces microscopiques foyers de lumière, a placé au-dessus de sa porte une vieille lampe emprisonnée dans une vieille lanterne. Est-ce assez primitif ?
Nous avons dit que la cité Dorée était le refuge des chiffonniers du quartier de la Salpêtrière, mais il n'y a pas que des chiffonniers; il y a aussi des camelots sans ouvrage, des équarrisseurs, des marchands de verre cassé, des chanteurs de la rue, de faux estropiés, des diseurs de bonne aventure, des saltimbanques, des larrons, des gouapeurs, des truqueurs et des grinchisseurs. Toutes les infimes industries des bas-fonds de la grande Ville, tous les métiers — malpropres ou inavouables — y ont leurs représentants.
Pendant les soirées d'hiver, les deux ou trois débits de boissons dont nous avons parlé se remplissent d'hommes, de femmes et même d'enfants qui vont boire là je ne sais qu'elles horribles liqueurs au rabais. Pour dépeindre la physionomie de ces bouges sans nom, vues à dix heures du soir, il faudrait la plume de Balzac. Quant aux conversations que l'on entend, on ne pourrait guère les reproduire qu'en latin. On y parle d'ailleurs un mélange de français corrompu et d'argot nouveau auquel il n'est pas facile souvent de comprendre quelque chose. « Nous nous sommes arrangé à l'amiable », veut dire qu'on a dévalisé quelqu'un sans lui faire du mal.
Le vol avec effraction s'appelle un fric frac.
Arrêtons-nous là.
De tout temps et sous tous les régimes la cité Dorée a été, de la part de la police, l'objet d'une surveillance spéciale. Les agents de Vidocq y arrêtèrent un soir, après une lutte acharnée, un nommé Mullot qui avait tué un marchand de bestiaux de Poissy et qui mourut sur l'échafaud. En 1867, on y découvrit également l'ex-boucher Davinant, l'auteur de l'assassinat commis sur la personne d'un nommé Duguet. Combard, forçat évadé de Toulon, parvint à s'y cacher pendant quinze mois ; il fut trahi par une femme et réintégré au bagne.
Nous pourrions citer d'autres particularités non moins curieuses. L'immeuble n° 8 de l'avenue Constance-Philippe appartenait au commencement de ce siècle à un nommé Durand, qui avait été, en 1793 et 1794, concierge de la maison 11° 18 de la rue de l'École-de-Médecine, où habitait Marat, dit l’Ami du Peuple.
Dans cette même avenue, la police de Louis-Philippe découvrit, en 1835, une presse clandestine qui servait à la Société des familles, organisée par Blanqui et Barbès. Au passage Doré, on peut voir encore une petite boutique de bouillon à la tasse et de pommes de terre frites, qui a été occupée pendant longtemps par la Femme Adèle, l'ancienne maîtresse de Lacenaire !!... Le chansonnier rôtisseur Chauvelot, qui a créé le village de Malakoff, a habité également le passage Doré.
CHARLES MÉRICAN.
On ne saura jamais si l'emploi de "cité Dorée" est dû à une méprise de l'auteur ou une inattention du typographe. En revanche, l'auteur est coupable d'approximations lorsqu'il évoque Vidocq, qui n'a pu connaitre la cité Doré en tant que chef de la sûreté, où le nom des voies découpant cette même cité. (NdE)
A propos de la Cité Jeanne d'Arc
La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.
Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.
Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."
Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."
Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.
Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.
Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.
Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.
Les premiers temps
- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)
- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)
- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881
- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)
- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)
La période "Assistance Publique"
- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)
- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)
- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)
- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)
Dix ans de blocage
- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924
- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)
- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)
- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)
Sur les évènements du 1er mai 1934
- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)
- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien
- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro
- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal
- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir
La fin de la Cité Jeanne d'Arc
- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)
- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)
- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)
- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)
- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)
- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)
- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)
Faits divers
- Un Drame du Terme (1902)
- Une cartomancienne assassine son ami (1921)
- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)
- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)
Autres textes de Lucien Descaves
La cité Jeanne d'Arc dans la littérature
- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)
- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)
- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson:
Sur la cité Doré
Le récit
Le lieu
- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)
- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859
- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859
- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859
- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)
- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)
- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882
- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)
- La cité Doré par Jean Soleil (1889)
- Les cabarets de la cité Doré (1890)
- Un coin curieux de Paris (1901)
- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)
- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)
La catastrophe de la Cité Doré
Faits-divers
Sur la cité des Kroumirs
"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.
Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.
De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.
Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."
Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)





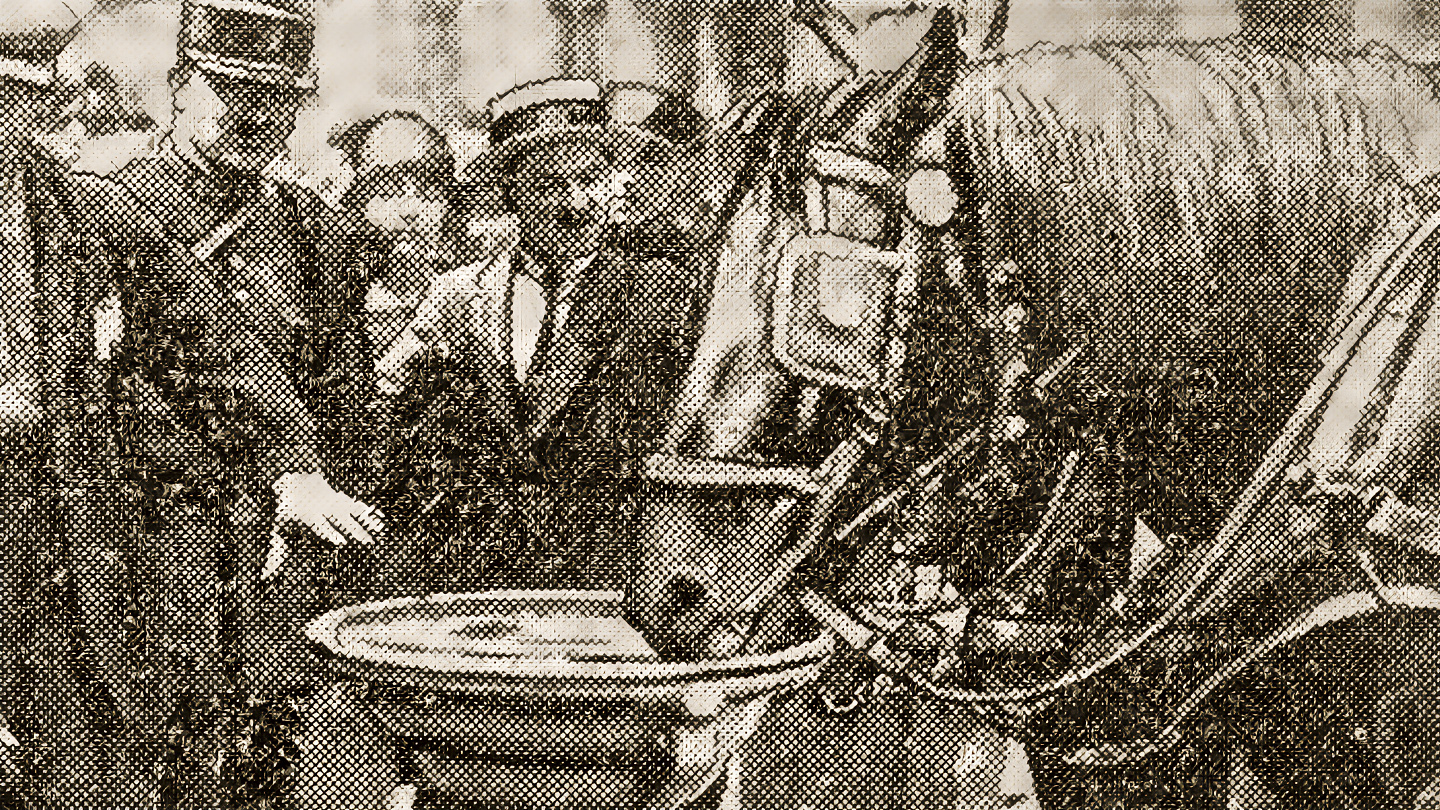
 Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.
Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.